Articles
Stress et performance au travail
Être ou ne pas Être… stressé ?
Êtes-vous sur votre « X » ? Votre situation est-elle confortable, peu stressante ? Êtes-vous capable de faire face à la situation en fonction des ressources et des compétences que vous avez ? Si parler de stress est dans l’air du temps, le comprendre s’avère plus complexe, selon Éric Gosselin. Ce professeur-chercheur mène des travaux sur la santé psychologique, et particulièrement sur les liens entre le stress et la performance au travail.
Par Thérèse Lafleur, rédactrice

« La croyance populaire veut qu’un stress d’intensité moyenne génère de la performance. Donc un peu de stress c’est bon, cela va vous motiver. Puis le stress va s’intensifier, c’est relativement fou ! La littérature scientifique nous dit que, de façon générale, nous sommes plus performants lorsque nous ne sommes pas stressés. Lorsque nous sommes sur notre “X”. » explique monsieur Gosselin, professeur titulaire en psychologie du travail et des organisations à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).
Le professeur Gosselin présente le stress comme un mécanisme d’adaptation aux situations d’urgence. Il permet d’aller chercher des performances. Le stress peut avoir un effet bénéfique si votre travail est de courir 100 mètres rapidement ou de soulever de lourdes charges. Les hormones stimulées par le stress, dont l’adrénaline et le cortisol, vont augmenter la puissance musculaire et le rythme de cardiaque.
Mais si votre travail est de réfléchir, d’analyser, de gérer, de prioriser ou de planifier, le stress ne sera pas un élément positif. Être sur son « X » au boulot, c’est avant tout pouvoir évoluer dans un contexte organisationnel propice à une saine gestion du stress au travail. Un sujet qui a vivement intéressé les participants au colloque 2025 de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).
Être conscient des stress qu’on s’impose
Monsieur Gosselin encourage la recherche d’un plus grand équilibre entre nos ambitions et notre situation. À se sentir sur son « X ». « Ce n’est pas mauvais de stresser de façon générale. Mais il faut être conscient de la manière dont nous utilisons ce mécanisme. Par exemple, les freins d’une voiture sont un mécanisme d’urgence. La façon dont ils sont utilisés dictera leur durée de vie. C’est la même chose avec notre organisme. Notre santé psychologique demande d’utiliser à bon escient le stress. Cela ne veut pas dire de ne plus se stresser. Ce serait impossible. Le développement d’une personne demande parfois de se stresser parce qu’elle a un nouveau poste ou relève des défis. »
Il faut être conscient des stresseurs présents dans notre environnement. Si vous décidez d’accepter un nouvel emploi, bravo ! Mais ne changez pas de maison, de voiture et de conjoint en même temps.
Dans les turbulences socio-organisationnelles, dont la pandémie, certaines personnes peinent à se repositionner sur leur « X ». « Même si je suis un spécialiste du stress au travail, mon organisme ne fait pas la différence entre le stress au travail, le stress familial ou le stress social. Mon organisme sécrète des hormones puis s’adapte. La pandémie est un bon exemple de situation où nous n’avions pas le contrôle sur tous les stresseurs réunis, peu importe notre situation. Nous étions à côté de notre “X”. »
En ce sens, monsieur Gosselin conseille de doser son exposition au stress sans pour autant reculer devant des défis motivants.Toutefois, il souligne l’importance de ne pas trop en demander à son organisme, d’éviter d’être en suradaptation.
Les indicateurs de stress
Les difficultés relationnelles sont des symptômes de gens très stressés, constate monsieur Gosselin.
« Mais au départ la personne ressent physiquement son stress. Elle a des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil. Ce sont souvent les premiers symptômes qui apparaissent et que nous appelons des symptômes temporaires. Il faut réaliser quand nous sommes stressés, que ce soit par choix ou autrement. Le stress va permettre de maintenir la stabilité de l’organisme, mais il a un coût. Je reviens à l’exemple des freins. Si vous êtes quelqu’un qui accélère et qui freine pour le plaisir ou une personne qui freine quand c’est nécessaire, les freins ne s’useront pas de la même manière. »
Les personnes qui sont sur leur « X » sont attentives à ce mécanisme d’adaptation qu’est le stress. Elles ménagent leurs freins. « Si elles décident de bouger de leur “X”, elles le font de façon volontaire. Si leur organisation impose un changement, ces personnes tentent toujours de retrouver leur équilibre. »
« Quand nous pouvons nous dire voilà, je suis sur mon “X”. J’ai tout ce qu’il faut pour faire face à la situation. Je suis confortable parce que je ne vis pas de stress. Je ne suis pas en demande adaptative. J’ai les compétences, les connaissances et l’expertise. Nous allons vivre du stress lorsque nous n’avons pas l’impression d’avoir les ressources nécessaires. » affirme monsieur Gosselin.
Gérer son stress
Dans son livre Par amour du stress[i], la chercheure en neurosciences Sonia Lupien identifie quatre facteurs qui génèrent du stress :
- La situation n’est pas contrôlable ;
- La situation est imprévisible ;
- La situation est nouvelle ;
- La situation menace l’estime de soi.
C’est la référence que suggère monsieur Gosselin pour savoir si vous êtes sur votre « X ». « À quel moment apparaît le stress ? Il apparaît lorsque l’une ou plusieurs de ces conditions se présente. »
Par contre, il distingue les stress positifs ou négatifs. La tension d’un professeur qui crée un nouveau cours se révèle une émulation intrinsèque constructive. Par ailleurs, la peur de l’échec à l’examen qui suscite un blitz d’étude crée une tension extrinsèque chez l’étudiant, une motivation qui n’est pas porteuse.
« Si vous voyez un ours en forêt, vous allez être stressé et motivé à courir. C’est une motivation de peur générée par le stress. Ce n’est pas une motivation intrinsèque reliée principalement à l’assouvissement de besoins supérieurs, tels que l’estime de soi, l’accomplissement, la réalisation. C’est cela que nous voulons générer en milieu de travail.» précise monsieur Gosselin.
Stress et performance
Dans le cadre de son travail, le professeur Gosselin, aussi chercheur au Laboratoire d’analyse psychoneuroendocrinologique du stress et de la santé (LAPS2-UQO), fait le lien entre le stress et la performance.
Et plus le stress est élevé, plus il altère la performance. En effet, l’analyse de 52 études menées entre 1980 et 2006 a permis de constater que 75 % de ces études confirment que plus le stress augmente, plus la performance diminue. Seuls 10 % de ces études identifient que la performance augmente avec un peu de stress et diminue s’il y en a trop peu ou trop.
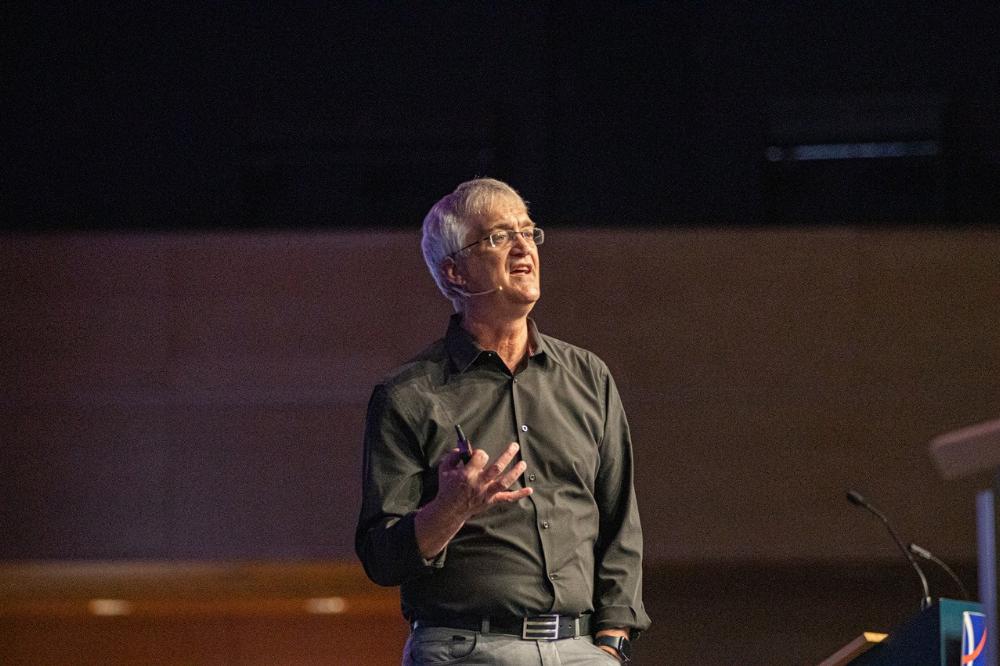
« Dans les fonctions cognitives, le stress ne fait pas bon ménage avec tout ce qui est préfrontal. C’est-à-dire avec tout ce qui est lié aux fonctions exécutives : réflexion, analyse, etc. De façon générale, nous ne sommes pas plus performants dans des tâches cognitives lorsque nous sommes stressés. Et de façon générale, nous sommes plus bêtes lorsque nous sommes stressés. Mais pas bête dans le sens de méchant, bête parce que cela freine notre savoir. Le stress c’est très bon pour se sauver d’un ours. Si votre travail est de courir, le stress peut vous aider. Mais il n’y a plus grand monde dont la tâche est de courir ou de soulever des charges. Aujourd’hui, il faut s’adapter au stress non pas pour courir, mais pour être performant au travail et de la façon dont nous travaillons maintenant. »
------------------------------------------------------------------
[i] LUPIEN, Sonia. « Par amour du stress », Éditions Va Savoir, 2020.




