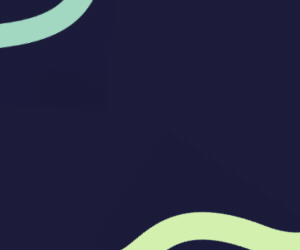Nouvelles
Le Devoir
«Contre la formation générale à la carte»
« Les matières de la formation générale sont des disciplines transmises par des universitaires qui ont pris le temps de les approfondir et qui exercent leur jugement afin de tisser des passerelles entre le passé et l’avenir », écrivent les auteurs.
Éric Martin, Mélissa Grégoire, Étienne Beaulieu, Marianne Di Croce et Yvon Rivard
Les auteurs sont respectivement professeur de philosophie (Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu), professeure de littérature (Cégep de L’Assomption), professeur de littérature (Cégep de Drummondville), professeure de philosophie (Cégep de Saint-Jérôme) et professeur de littérature retraité (Université McGill). Ils ont l’appui de plus de 800 signataires issus du milieu de l’enseignement*.
Tous les cinq ou dix ans, la formation générale au collégial est remise en cause. On l’accuse d’accorder trop de place à ceci ou pas assez à cela pour ensuite réclamer qu’elle soit arrimée à quelque nouvelle préoccupation du moment. La semaine dernière, la Fédération étudiante collégiale (FECQ) a ressuscité une idée (poussiéreuse ?) déjà débattue en 2019 : calquer le réseau francophone sur le modèle des « humanities » des collèges anglophones, sous prétexte que les étudiants trouveraient leurs cours moins ennuyants s’ils pouvaient les choisir parmi des options thématiques.
Cette proposition, qui privilégie la préférence des individus au détriment du fonds culturel commun, constitue une menace pour l’intégrité de la formation générale ainsi fractionnée et soumise à l’arbitraire des goûts changeants des étudiants ou de l’actualité.
Description caricaturale et inexacte de la formation générale
Quand on veut tuer son chien, on prétend qu’il a la rage. Qui veut mettre la hache dans la formation générale doit d’abord la présenter rhétoriquement comme ringarde, « poussiéreuse », déconnectée et figée dans les années 1970. On continue d’accoler cette image caricaturale au travail des professeurs de la formation générale, même si la réalité est tout autre.
Ces derniers actualisent sans cesse leurs cours, lisent les oeuvres anciennes et contemporaines à la lumière des enjeux et débats de société (écologie, féminisme, question linguistique, cultures autochtones, etc.), auxquels ils participent par des publications et des interventions publiques. Il est ainsi erroné de prétendre que la formation générale n’a pas bougé depuis 30 ans.
Le client est roi ?
Après avoir dépeint les pratiques actuelles comme des reliques moyenâgeuses, on brandit le remède miracle : si les étudiants pouvaient choisir des cours plus alléchants, allégés, qui correspondent à leurs « intérêts et objectifs » de carrière, ils réussiraient mieux leur parcours. La formation devrait ainsi être pensée à partir de l’intérêt particulier du client.
Fin de « l’obligation » d’étudier une matière. Fin de la gratuité intellectuelle, qui permet à plusieurs un premier et peut-être dernier élargissement de la pensée avant son application à un métier.
À Radio-Canada, un étudiant, qui rêve de devenir politicien, disait avoir aimé étudier de grandes figures comme Desmond Tutu ou Martin Luther King. L’exemple du docteur King est étrangement choisi, puisque ce dernier était un grand lecteur des classiques. Il appuyait ses écrits sur Platon, Sophocle ou Eschyle, des livres qu’on ne devrait pas lire s’ils ne suscitent pas immédiatement notre intérêt, suivant ce que prétend le lobby de la FECQ, dont la position a cependant le mérite de clarifier le débat : faut-il partir de l’intérêt immédiat (et toujours différencié) de chacun ou penser ce que les Grecs appelaient la paideia, la formation de l’esprit, à partir d’un autre lieu, celui de l’entrée dans un univers culturel et symbolique commun ?
S’affrontent ici deux conceptions, que l’on pourrait appeler libérale ou néolibérale et républicaine, de l’éducation. Dans cette dernière, il ne s’agit pas de subordonner l’apprentissage à l’intérêt personnel du client, mais précisément de sortir de soi pour entrer en possession d’un héritage qui nous dépasse.
Entrer dans un monde commun
Hannah Arendt soulignait, dans La crise de la culture, que l’éducation des nouveaux venus suppose de leur transmettre les clés de compréhension du monde commun qu’ils reçoivent en héritage, déplorant la ludification croissante de l’enseignement aux États-Unis. Bien sûr, la jeunesse doit pouvoir construire l’avenir et « changer le monde », mais paradoxalement, elle ne pourra y parvenir sans savoir d’où vient ce monde et quels sont les récits et les idées sur lesquels il s’est bâti.
L’amélioration de l’avenir a comme condition la réception d’un héritage passé, amassé par les sociétés et les civilisations, lequel ne saurait se réduire à l’intérêt immédiat et à courte vue de l’individu. Personne ne prétendrait qu’il suffit, pour apprendre la physique, la chimie ou la sociologie, de discuter uniquement de ce qui fait plaisir ; il en va de même pour la philosophie et la littérature, qui exigent des connaissances dont l’apprentissage est irréductible à l’amusement.
La liste complète des signataires est en ligne.