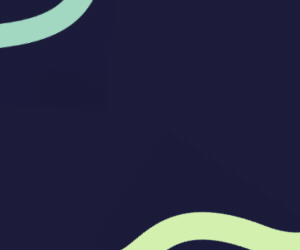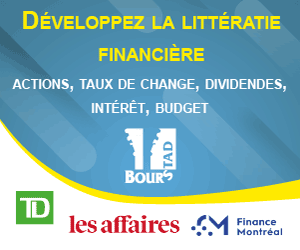Nouvelles
Cégep de Sherbrooke
Une équipe de recherche établit un lien entre pollution lumineuse et cancer

Photo: Johanne Roby Dans le cadre d'une étude, des étudiants du cégep de Sherbrooke ont pris des photos nocturnes dont la proportion de lumière bleue a été analysée.
Florence Tison - Cahier spécial du Devoir
Le prix Acfas Collaboration interordre récompense une équipe mixte de recherche formée par des établissements collégiaux et universitaires. Cette année, l’équipe lauréate comprenait même des élèves de 4e et de 5e secondaire !
Les étudiants de tous ces ordres se mentoraient les uns les autres, les universitaires épaulant les cégépiens, qui eux-mêmes prêtaient main-forte aux élèves du secondaire. « Ce qui est intéressant aussi, c’est qu’il y avait du mentorat inversé, souligne la professeure et chercheuse au Département de chimie du cégep de Sherbrooke Johanne Roby. Les étudiants du cégep expliquaient aux étudiants universitaires le processus de fonctionnement, et il y a des élèves du secondaire qui aidaient des étudiants du cégep à mieux comprendre ! »

Photo: Photo fournie par la lauréate Johanne Roby, professeure de chimie au cégep de Sherbrooke
Les résultats préliminaires de l’étude, qui est en cours de révision, indiquent que la lumière artificielle extérieure a une incidence sur les risques de cancer agressif de la prostate. « Les résultats sont assez spectaculaires, et c’est la première fois qu’on établit ce genre de lien là », dit avec enthousiasme Marie-Élise Parent, professeure titulaire au centre Armand-Frappier santé biotechnologie de l’Institut national de la recherche scientifique.
Mesurer la pollution lumineuse
Pour arriver à ces résultats, l’équipe interordre a analysé la luminosité nocturne autour des lieux de résidence de 4000 patients atteints du cancer de la prostate, en utilisant leurs coordonnées géographiques précises (anonymisées) et des photos prises de nuit par les astronautes de la Station spatiale internationale.
Épaulée par l’équipe du secondaire, l’équipe collégiale a analysé la proportion de lumière bleue dans d’autres photos nocturnes prises par les étudiants sous la direction des professeurs Martin Aubé — professeur au Département de physique — et Johanne Roby du cégep de Sherbrooke. La lumière artificielle a aussi été mesurée en pleine nuit grâce à divers instruments, tels des luxmètres et des télémètres laser.

Photo: Photo fournie par le lauréat Martin Aubé, professeur de physique au cégep de Sherbrooke et professeur associé en géomatique à l’Université de Sherbrooke
Les équipes collégiales et secondaires ont par la suite cartographié les sources de lumière artificielle d’un quartier donné et les obstacles à leur diffusion, comme les arbres et les bâtiments, de façon à calculer précisément à l’aide de polygones la quantité de lumière pénétrant la nuit dans les maisons.
L’équipe universitaire en épidémiologie étudiait, quant à elle, les liens entre cette pollution lumineuse et le cancer de la prostate au sein de la cohorte de 4000 patients, sous la supervision de la professeure Marie-Élise Parent. Les étudiants du centre Armand-Frappier santé biotechnologie ont intégré les données de leurs collègues du cégep à un modèle comportant un indice de suppression de la mélatonine due à la lumière artificielle, le déséquilibre de cette hormone étant associé à l’incidence de cancer hormonal comme celui de la prostate.
On a découvert que les patients les plus exposés à la lumière artificielle nocturne à la maison étaient plus à risque de développer une forme agressive du cancer de la prostate. Des résultats encore préliminaires, mais qui interpellent.
En tant qu’assistants de recherche, les élèves et étudiants ont vécu une participation authentique à l’avancement de la science dans le cadre d’un réel processus d’enquête, plutôt que de celui d’un atelier avec des résultats connus d’avance. Une expérience qui fera peut-être naître des vocations alors qu’on observe depuis plusieurs années un déclin de l’intérêt pour la science et la technologie des jeunes du secondaire, et même du postsecondaire. Des études du Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en faisaient déjà état il y a plus de dix ans.